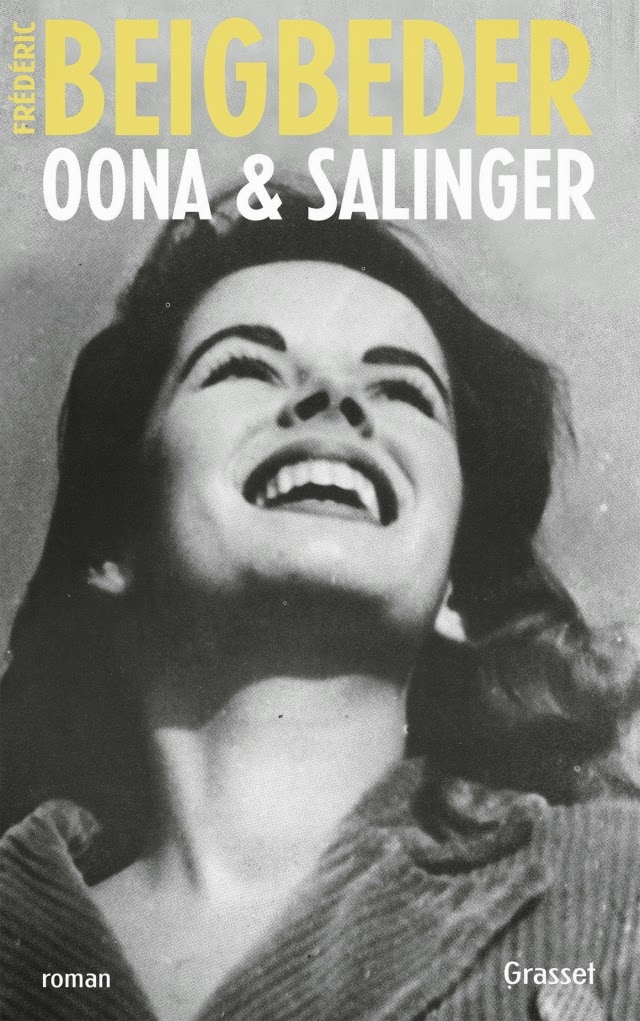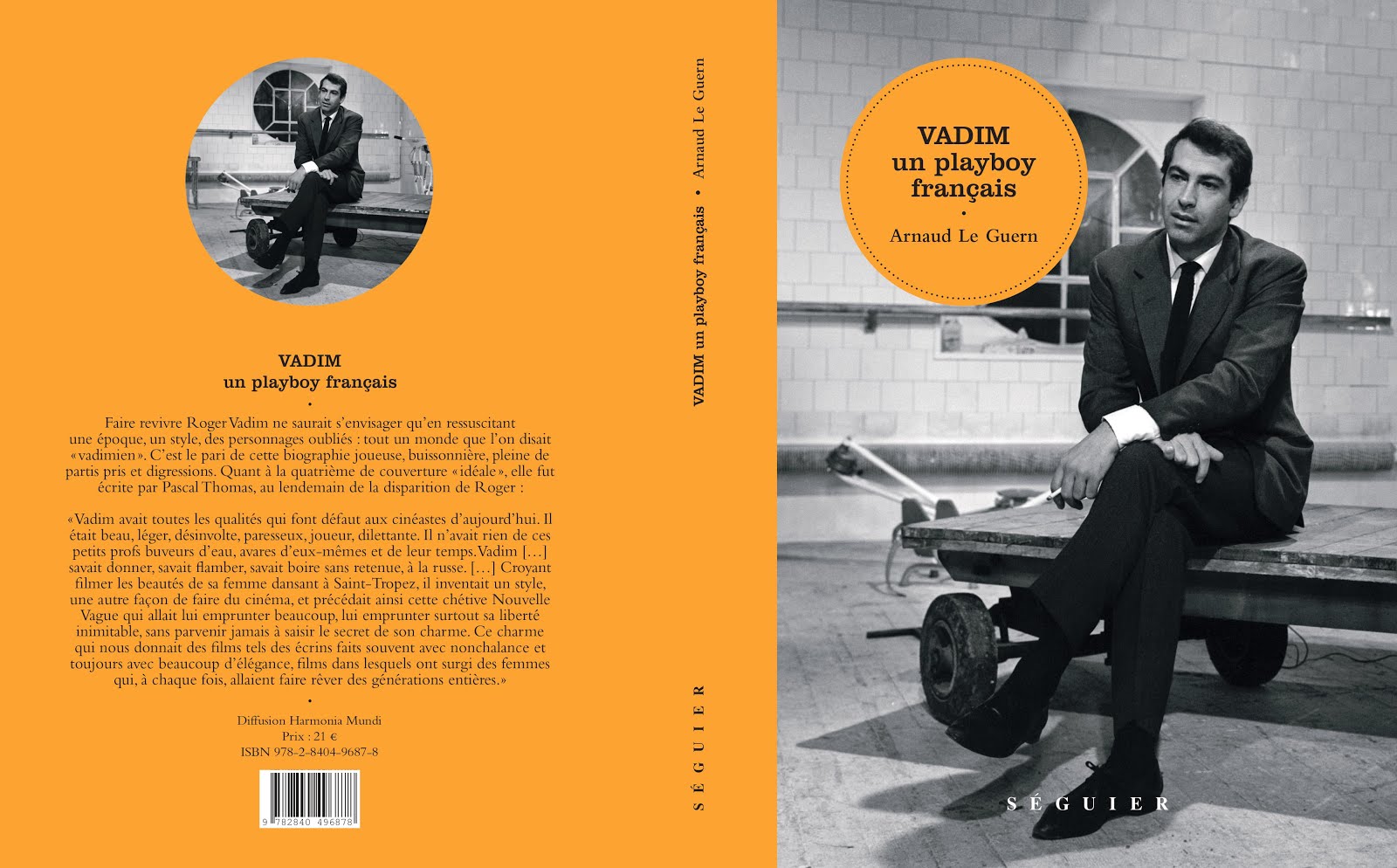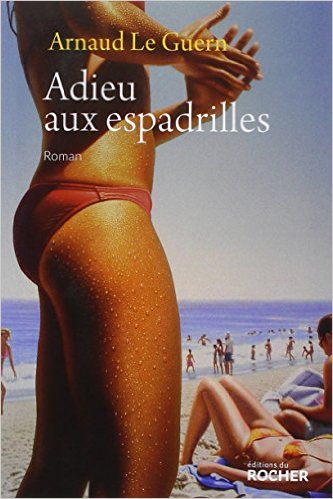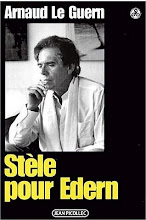C'était
le début des années 70. Il est bon de se souvenir. Le cinéma était
une affaire d'écrivains. La « politique des auteurs »,
chère à la Nouvelle Vague, ne tenait pas le coup. Sacré Truffaut :
« Je
ne conçois d'adaptation valable qu'écrite pas un homme de cinéma. »
Il ne manquait pas d'air. Il suffit de laisser défiler le générique
des films. Le nom des écrivains (de cinéma), autrement appelés
scénaristes, s'y affichait en lettres capitales. Michel Audiard
faisait du Audiard. Pascal Jardin adaptait Simenon et Félicien
Marceau. Paul Gégauff était l'âme damnée de Claude Chabrol.
Daniel Boulanger soignait les dialogues de Philippe de Broca.
Jean-Loup Dabadie et Claude Néron, eux, œuvraient avec Claude
Sautet.
Si
Dabadie, feu follet et plume des meilleures comédies françaises,
n'a plus à être présenté, on sait peu de choses sur Claude Néron.
Un oublié des manuels de littérature et de wikipedia. Né en 1926 à
Paris, la guerre lui donne l'occasion de faire l'école buissonnière.
Tel un romancier américain, il passe d'un métier l'autre :
groom, ébéniste, fourreur, chauffeur de taxi, courtier en
publicité, ferrailleur, joueur de bridge (liste non exhaustive).
Mais Néron n'a qu'une envie : écrire. Ce qu'il fait, dans un
style noir, lyrique et populaire. La NRF publie en 1964 un texte :
« Le Combat de boxe ». Suivront des romans : La
Grande Marrade
(1965), Max
et les ferrailleurs
(1968), Mado
(1976)
et Les
chiens fous
(1983). Tous seront adaptés sur grand écran : par Claude
Barrois pour le dernier, sous le titre Le
Bar du téléphone ;
par Claude Sautet pour les autres, La
Grand Marrade
devenant Vincent,
François, Paul et les autres.
Néron est mort en juin 1991.
Max
et les ferrailleurs,
paru chez Grasset, est à l'origine de sa rencontre avec Sautet, qui
vient de connaître le succès avec Les
Choses de la vie.
Sur les conseils de son producteur, Sautet s'intéresse à l'histoire
de ce flic, Max, qu'obsède l'idée de piéger en flagrant délit une
vieille connaissance, Abel, et son gang de ferrailleurs. Il ne lit
pas immédiatement le roman, demande d'abord à sa scripte, Geneviève
Cartier, de le faire : « Ma
cocotte, tu vas lire ce livre et tu vas m'en faire le résumé. »
Geneviève proteste ; Sautet répond : « Je
ne te demande pas ton avis. »
Le récit commence en août 1962, se déroule sur huit chapitres et
s'achève le 5 octobre de la même année. Après lecture du résumé,
Sautet se plonge enfin dans les mots de Néron : « Vêtu
d’un slip, Max n’était plus tout à fait le même que lorsqu’il
était en complet veston. Dans ce dernier état, il pouvait passer
pour un homme jeune, grand, assez chétif, les cheveux blonds, coupés
ras, au-dessus d’un visage de poupée mécanique. Nu, Max n’était
plus exactement pareil et plutôt un solide welter à la limite des
moyens. En fait c’était un mi-lourd naturel aussi rapide qu’un
léger. Il savait très bien boxer. Il savait faire d’autres
choses, mais il savait très bien boxer quand il en avait l’occasion,
et il en avait souvent l’occasion. Il tirait très bien aussi, et
les flics furent contents de l’avoir avec eux. »
Fasciné
par les boxeurs, Sautet accroche, poursuit. Enfant de Montrouge, le
réalisme des descriptions de la banlieue parisienne le touche. On
s'y croit ; on y est. Néron nous entraîne jusqu'à Nanterre,
« cet
ancien village qui vit naître vers 420 ou 421 sainte Geneviève,
patronne de Paris, et qui est devenue cette ville industrielle
dépassant cinquante mille habitants. »
Il y a
également des scènes de bistrot, des automobiles à l'honneur, des
petits truands et des vrais durs qui ne dansent pas. Tout ce que
Sautet apprécie. Le bandeau du roman, par ailleurs, lui donne un
« pitch » parfait : « Conséquences
de l'amateurisme chez les voyous de la Plaine. »
Max
et les ferrailleurs,
c'est décidé, sera son prochain film.
Lui
et Néron commencent à travailler sur le scénario, dans un studio
de la rue de Ponthieu. L'intrigue prend forme, suivant la narration
du livre ; le contour des personnages se dessine. Michel Piccoli
sera Max ; Bernard Fresson, Abel. Problème : on cherche la
femme. Dans le roman, il y a une certaine Lily, la « poule »
d'Abel, mais elle ne fait que passer. Ça manque d'épaisseur pour
Romy Schneider, que Sautet veut dans son film. Jean-Loup Dabadie est
appelé à la rescousse. Il s'agit de développer Lily, tout en
gardant la noirceur de l'histoire. La fin du roman, en outre, ne
convient pas à Sautet : « Abel
était tué ; Max ne tuait pas Rosinsky ; il restait au
café à discuter. »
Une nouvelle fois, Dabadie débloque la situation : un échange
de regards, intenses et lointains, entre Max et Lily.
A
la (re)lecture, le roman de Néron séduit par sa langue au plus près
de la dureté d'une époque où rôdent encore les fantômes de la
guerre et les « événements d'Algérie ». Max, dit le
fou, incarne ce temps, froideur et violence mêlées. Le film, lui,
nous émeut par son sens inéluctable de la tragédie en marche et
par la grâce de Romy Schneider. Elle est tour à tour forte et
fragile, sourire aux lèvres et les yeux noyés de chagrin. Parée
d'un déshabillé noir ou d'une robe rouge ou mauve, nue dans son
bain avec un chapeau pour unique ornement, photographiée par
Piccoli, ou la voix pleine de colère - « Tu
es un sale type ! »
-, on ne voit qu'elle. Son image ne nous quitte pas. En attendant de
la redécouvrir, charme toujours à vif, dans César
et Rosalie,
Sautet millésimé 1972, sur un scénario une nouvelle fois signé
Claude Néron et Jean-Loup Dabadie. La fine équipe du cinéma
français.
Préface à la réédition de Claude Néron, Max et les ferrailleurs, "Un roman, un film culte", Archipoche