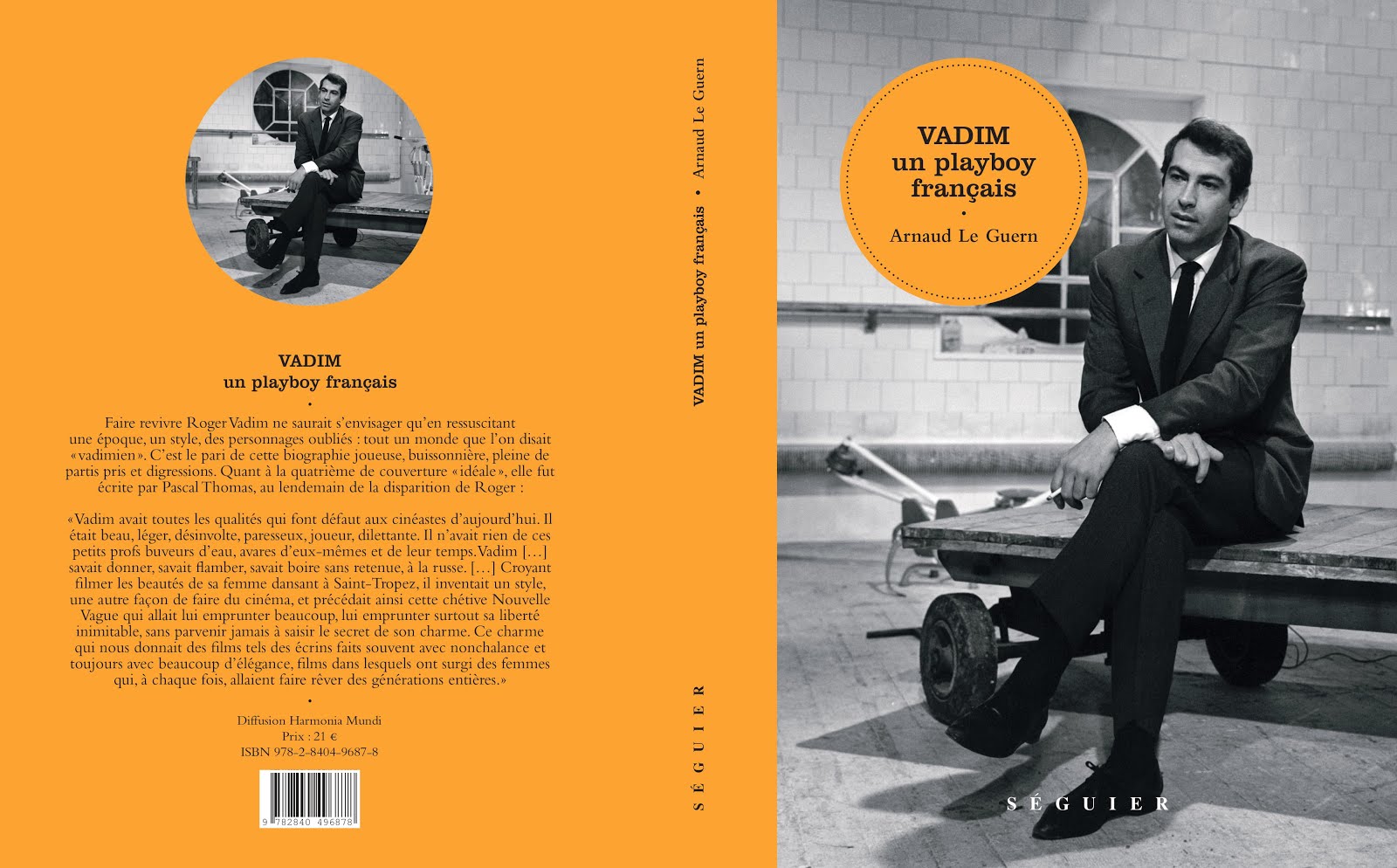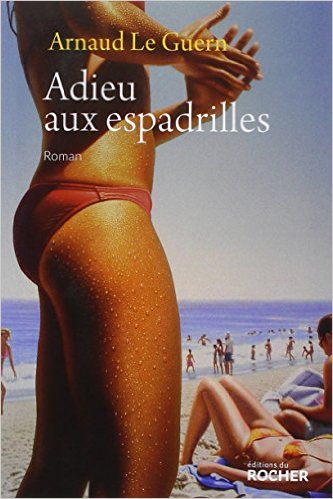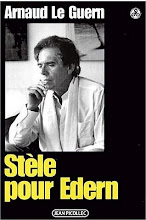lundi 22 octobre 2007
La solitude du salarié au moment de l’embauche
Quand il achève ses études, Guillaume porte nonchalamment une lassitude Houellebecquienne à la boutonnière : « Il fallait bien masquer l’ennui, la paresse attentive des étés au bord de la mer, dans le Morbihan. » Connaissant les règles du jeu, il trafique son curriculum vitae afin de répondre à une offre d’emploi. Rapidement, il est embauché comme International legal coordinator dans une société en pleine santé financière : « Je parlais de mon entreprise avec fierté […] J’étais content, c’était peut-être le bonheur. » Tout se passait tranquillement quand sa petite amie s’en est allée, lâchant : « Tu n’es pas quelqu’un d’exceptionnel ». Les journées de Guillaume se sont alors résumées à un fast food du soir partagé avec sa mère et à la vie de bureau. Une vie que Jeune professionnel épingle, sans haine et sans violence, de ses notations ciselées. Des blagues grasses du vieux collègue aux interminables Friday meetings sans intérêt, de fantasmes lointains en étreintes tièdes entre les bras d’une voisine d’open space : rien ne manque au tableau de chasse de Noyelle qui n’oublie pas, non plus, de faire un sort à celle qui aura sa peau : « On ne peut pas décevoir au premier abord mais déplaire, ce qui est moindre. D’emblée, Véronique paraissait sûre de sa valeur, une valeur surévaluée, spéculative. » Une fois licencié, ne restent que quelques souvenirs en clair-obscur : un exemplaire de Claire de Chardonne feuilleté aux toilettes, la silhouette fugitive d’une jeune fille « à l’allure disloquée » et une sentence qui paraphe la misère de la vie salariale : « A force de paraître, on finit par être. »
in L'Opinion indépendante, le 19/10/2007
jeudi 18 octobre 2007
Un peu de joie
. Trinquer avec Thierry Marignac, gentilhomme cambrioleur du style. L'écouter. Le lire - 9'79", Snatch (texte anglais de Bruce Benderson) - dans la collection "Compact livres" du Dernier terrain vague.
. Cécilia encore plus libre que Max ou qu'une infirmière bulgare.
. Les saisons 1,2 et 3 de The Wire, ce que la télévision a offert de meilleur. Pelecanos, Price et Lehane à l'écriture.
. Un pull noir sur une peau blanche.
. Un costard-cravatte, sur son velib', finit le cul par terre.
. Le Basque de la rue Keller, Paris 11e.
. Les jambes de Faye Dunaway dans Barfly.
. "La plus jolie fille du monde", première nouvelle des Contes de la folie ordinaire de Charles Bukowski.
. Le dernier verre d'Antidote avant la fin du monde.
. La dernière Lucky Strike aussi.
. Le sourire de ma Lou'.
. Les chroniques rugbystiques de Sébastien Lapaque dans L'Opinion indépendante (En fait : lire tout Sébastien Lapaque).
. Le grain de folie de Frédéric Michalak.
. Les grains de beauté au coeur des décombres.
vendredi 12 octobre 2007
W.I.P.
De jolies demoiselles m'aiment un peu, beaucoup, à la folie, puis pas du tout. Elles s'appellent Elsa ou Djamila. Elles croient à mes sourires, à mes mots, à mes caresses. Elles me donnent leurs lèvres et le fond très doux de leur coeur. Avant de choisir, sur le fil du rasoir, le chemin des fugues.
L'amour fou, elles en ont leur claque. Trop de folie, l'amour passé à tabac. Trop de traces laissées comme des poings qui s'écrasent sur un beau visage. Trop de corps à corps où, ivre au milieu du ring, je hurle mes incohérences :
_ Mais qu’est-ce que tu fous avec une ordure dans mon genre ? T’es pas faite pour moi, t’es faite pour rien, pour personne. Casse-toi ! Je suis le fou qui t’aime et que tu n’arrives jamais à comprendre. Toujours trop léger ou trop lourd pour toi, toujours cynique et rafistolé. Ne me pardonne surtout pas toutes mes offenses… Tranche moi la gorge ! Approche toi et tranche ! Fais-le, bordel ! Tu veux que je te montre ? Tu veux le mode d’emploi ? Tu l’as pas vu à la télé ? Moi je t’aime. Je t’aime, je suis un peu saoul mais je t’aime. Il faut que tu m’entendes pour une fois. Pourquoi tu pleures ? Qu’est-ce que je t’ai dit ? Mais occupe toi de moi ! Fais quelque chose ! Parle ! Ouvre ta gueule, putain… Un baiser, donne-moi un baiser !
Les jeunes filles, l'alcool, c'est ça le problème. Je suis tombé dedans quand j’étais petit. Pour m’arracher à l’immonde qui, partout, pose ses sales pattes, j’ai misé toutes mes billes sur la beauté. La beauté des femmes, de la langue et de quelques paysages de la fin de la terre. La beauté des rasades, leur lente morsure tordant le cou à l'effroi. J’ai joué ma carcasse à la roulette de mes excès et tout perdu au fond de mauvaises bouteilles.
Pendant des années, personne n'a rien vu. Peu importe le lieu, je n’en faisais qu’à mes envies. Une sensuelle miss lovée contre moi et un verre de Martini-gin jamais loin. Je parlais de politique et de poésie, de chansons douces et de dessous chics. Les mots s’arrachaient dans leur habit de lumière, succession de fusées qui illuminaient la nuit. Rien ne pouvait m’arrêter et rien n’arrêtait ma descente. Les verres s’alignaient pareils à des cadavres attendant ma bénédiction. En fin de soirée, pour un rien – « On rentre, mon amour ? », venaient les premières colères, les bouteilles fracassées, les tables qu’on renverse, les dérives au creux d’autres corps. Puis les trous noirs. Les matins fumeux où la mémoire se fait la malle, où seul le regard abîmé d'une belle de nuit me rappelait l’ordurerie ininterrompue de mes éclats.
Le résultat ? Entre des murs blancs qui rendent plus fou que les fous, j’écoute le professeur Jevoitou, le chef du service de psychiatrie du Val-de-Grâce, me lâcher :
_ Vous gâchez tout, monsieur Vailland !
Toujours les mêmes mots qui reviennent. Chez Jevoitou, comme chez Elsa et Djamila. Impossible de sortir de ce cercle infernal. Impossible de retrouver la trace du « charmant garçon » que j’étais, celui dont ma mère aime se rappeler quand, chaque jour, elle prend de mes nouvelles.
_ Tu es sûr que ça va ?
_ Oui ça va. Je suis fatigué mais ça va.
Je dis toujours que « ça va » pour ne pas avoir à parler davantage. Je dis que « ça va » pour que ma mère ne s’inquiète pas. Je veux qu’elle garde intact le sourire délicieux qui éclaire son visage.
Ma mère, pourtant, sait que j’ai lâché la rampe. Elle le comprend au son de ma voix, pareille à un chewing gum trop mâché. Il est loin le bambin auquel elle tricotait un bonnet en laine que j'enfilais pour partir – la main dans la main de mon père – encourager le FC Brest-Armorique où brillait un numéro 10 paraguayen nommé Cabanas, prénom Roberto. Il est loin l’ado frondeur qu’elle allait chercher, en pleine nuit, dans les rues qui menaient des bars de Recouvrance à la maison, le même ado qui l’accompagnait au théâtre admirer un solo de Sylvie Guillem. Ma mère se rappelle aussi les blondes poupines, les rousses d’airain, les brunes sanguines, qu’elle découvrait au petit déjeuner, après une soirée où j’avais fracassé sa Ford Fiesta bleue dans un fossé boueux. Elle les aimait bien mes petites amoureuses. Au téléphone, elle termine toujours nos conversations en me demandant :
_ Qu’est-ce qui a bien pu se passer Théo ?
Je lui réponds :
_ Rien maman, il ne s’est rien passé. C’est comme ça…
Au Val-de-Grâce, je ne suis plus qu’un professeur de science politique sans étudiants, un écrivain en cale sèche, un serial loveur alcoolique sur la tombe duquel on pourra graver, en dessous de mon nom :
IL A TOUT GACHE
Le souffle en berne, les jambes coupées, le bide gonflé de larmes incendiaires, il ne me reste que mes souvenirs pour oublier le retour des tremblements, pour ne pas crever tout de suite.
[ à suivre...]
Inscription à :
Articles (Atom)