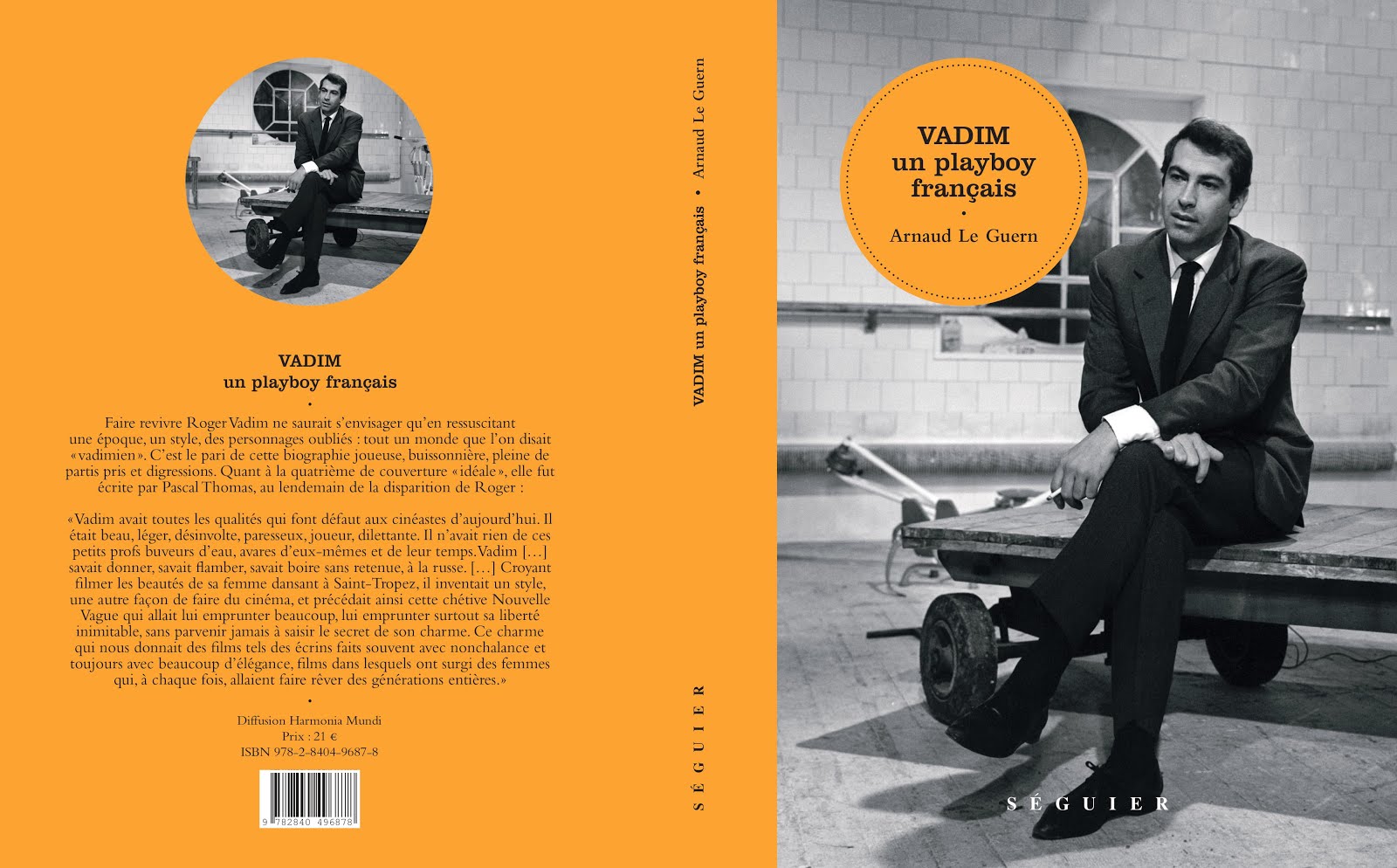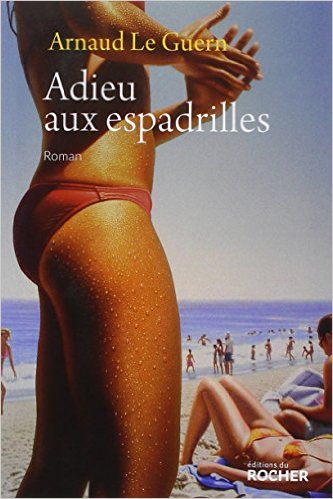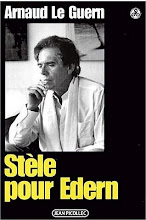L’injustice, parfois, tient à de petites choses. En cette année de commémoration Stendhal – il est né le 23 janvier 1783 – Dominique Fernandez lui consacre un parpaing de 800 pages dans la collection « Dictionnaire amoureux ». En bon spécialiste du genre – il en a déjà rédigé deux sur l’Italie et la Russie – Fernandez découpe Stendhal avec un sérieux très alphabétique. Il exécute les figures imposées, impressionne les gogos par la masse d’informations brassées. Stendhal, pourtant, ne surgit pas des pages de Fernandez : trop de lourdeurs, zéro émotion. A l’inverse, Stendhal est tout entier, terriblement vivant, dans la flânerie rapide, enlevée et stylée de Gérard Guégan : Appelle-moi Stendhal.
A
travers
une
quête
qui
commence
le
mardi
22
mars
1842,
jour
de
la
mort
de
Stendhal,
Guégan
nous
permet
de
répondre
à
une
question
simple :
qu’est-ce
qu’un
écrivain
français ?
Né
Henri
Beyle,
Stendhal a
écrit
ces
romans
qu’on
lit
à
l’adolescence,
pour
ne
plus
les
lâcher :
Le Rouge et
le Noir et
La Chartreuse
de Parme.
La langue est trépidante : lyrisme sec, cavalcade nette. Les
garçons se rêvent Julien Sorel ou Fabrice Del Dongo, tombent sous
le charme de Clélia Conti et Mathilde de la Môle. Du
vivant
du
romancier :
aucun
succès.
Les Français ne comprennent rien, au contraire des Italiens. Sur sa
tombe, penser à faire graver : « Arrigo
Beyle, Milanese ».
Peu importe, Stendhal écrit, dans la facilité ou la douleur, se
moquant des genres : Lucien Leuwen,
De l’amour,
des chroniques, son Journal. Guégan note : « Un
professeur d’énergie, et un camarade de parti. Le seul qui compte.
Le parti des âmes sensibles. »
Un
parti auquel Guégan appartient sans conteste. Pas seulement parce
que, comme Stendhal, il ne déteste pas les pseudonymes :
Stéphane Vincentanne, Freddie Lafargue et Philippe Carella, parmi
nos préférés. Guégan, surtout, a toujours fait sienne la liberté
absolue dont Stendhal chargeait ses mots. Une des raisons, sans
doute, pour laquelle l’histoire officielle n’a jamais été son
dada. Il l’a montré en retoquant Debord ou, dernièrement, en
retraçant le destin noir et tragique de Jean Fontenoy dans Fontenoy
ne reviendra plus (Prix
Renaudot Essai 2011).
Dans
Appelle-moi Stendhal,
Guégan, plus que jamais, n’en fait qu’à sa fête. Il suit son
modèle à la trace, le tutoie. Diplomate de carrière, Stendhal
n’est pas mort en sortant du ministère des Affaires étrangères.
Il était au 9 rue de l’Arcade, dans un bordel, avec un compagnon
de plaisir : Joseph Lingay, « le
plus corrompu des corrupteurs »,
l’âme damnée de la Monarchie de Juillet. Pour que les menus vices
ne s’ébruitent pas, Lingay décide d’oeuvrer pour la gloire de
Stendhal. Ca tombe bien : « L’écriture,
c‘est du désir et de la jouissance, et rien d’autre. »
Mis dans la confidence, Guégan est aux anges et aux diables. Se
jouant du temps, il hante les tavernes enfumées où l’on boit sans
fin, fait dialoguer Gobineau, le dandy sulfureux de l’Essai
sur l’inégalité des races
et des Pléiades,
et Jean Prévost, mort sous les balles allemandes le 1er
août 1944 ; Jacques Laurent, auteur d’un lumineux Stendhal
comme Stendhal, et
Paul-Emile Daurand-Forgues, alias Old Nick, le premier et l’un des
très rares à avoir salué La Chartreuse de Parme.
Entre les lignes, Balzac passe, Roger Vailland et Jean Dutourd
également. Ils croisent les muses cachées ou assumées du maître,
des femmes mariés, des actrices, des putains: Alberthe de Rubempré,
Jules Gaulthier, Clémentine Curial, on en oublie. Pour des raisons
parfois peu avouables, les messieurs et les dames ne jurent plus que
par Stendhal. Une exquise Monelle revient même d’une nuit d’amour,
sur la plage du Prado, en 1958. Avec elle et avec Guégan,
concluons : « Et
maintenant, Gobineau, le temps des plaisirs s’achève, refaisons
l’amour. »
Gérard Guégan,
Appelle-moi Stendhal,
Stock, 2013
Dominique Fernandez,
Dictionnaire amoureux
de Stendhal,
Plon, 2013
Papier paru dans Causeur Magazine, mai 2013