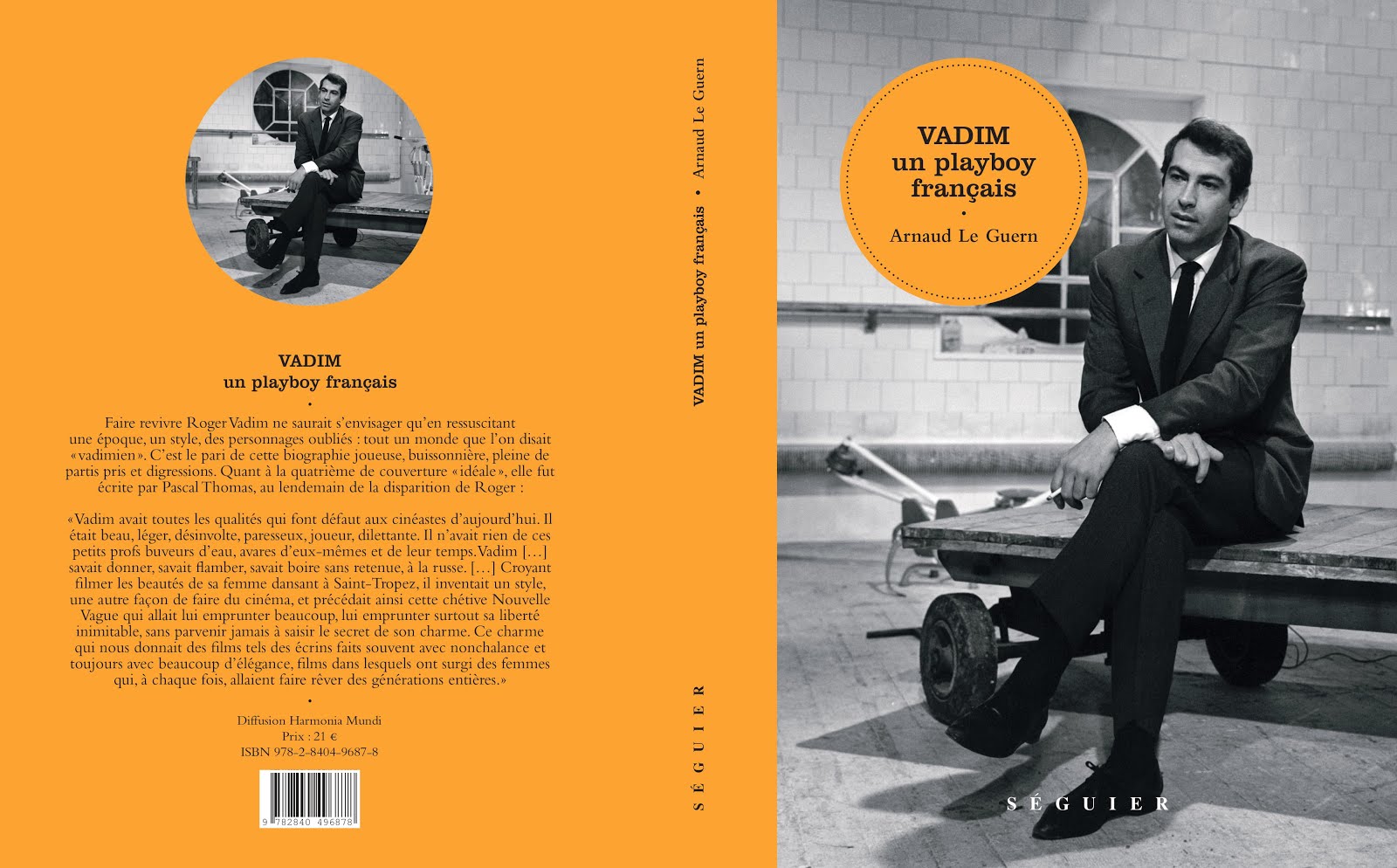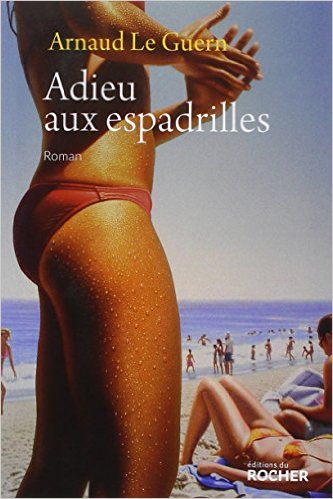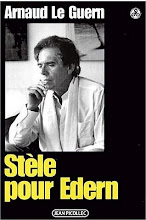Elsa s’était postée au comptoir boisé du bar. Elle avait retiré manteau et béret. Le regard absent, elle croisait de longues jambes où s’enrouler. Dans le verre qu’on venait de lui servir, les couleurs s’amusaient à brouiller les pistes. Du jaune, du blanc, un peu de glace. Un Gin-Fizz, sans doute.
Bastos aux lèvres, Théo la découvrit de profil. Son visage avait une pureté de poupée gothique. Elle portait un chemisier rouge incrusté de dentelles. Un crucifix en or appelait la prière à la naissance des seins. Une prière contenue par la fine attache blanche du soutien-gorge, sur l’étroite bande de peau révélée d’un glissement progressif. La fente de sa jupe noire captait toute la lumière du
Bonnie and Clyde, laissant seulement un peu d’ombre pour des talons beaux et fins comme la nuit de ses bas.
Théo ne quittait pas Elsa des yeux. Ce qui existait autour d’eux était sans importance. Les couples attablés, les solitaires, les conversations : il s’en tapait. Seules comptaient, à ce moment précis, les lèvres d’Elsa.
Au son d’une mélodie black, elles s’animèrent avec la délicatesse d’un brin de lilas. Une chanson douce et triste que Théo interrompit en s’adressant au barman.
_ Une bouteille de Martini et une bouteille de Gin. Et quelques friandises pour mademoiselle.
Elsa tourna la tête vers Théo. Elle le dévisagea de ses yeux de chatte aux paupières mi-closes, tout en sortant une marlboro de son paquet blanc. La cigarette allumée, elle dégaina d’un sourire mutin :
_ Je vous ai amené où vous vouliez ?
La voix d’Elsa était le prolongement de son sourire. Elle se gorgeait d’une joie enfantine et séductrice sur laquelle passait un voile rauque.
Son verre à la main, Théo répondit simplement :
_ Je suis chez moi là où la grâce se pose.
Elsa éclata d’un rire très tendre. Elle rappellerait souvent cette phrase à Théo. Ca l’avait touché plein cœur. Les hommes, d’ordinaire, l’entretenaient peu de la grâce. Elle avait aimé le mot et la manière qu’avait eu Théo de le prononcer, avec sincérité et arrogance.
Grillant cigarettes sur cigarettes, ils parlèrent comme s’ils se connaissaient depuis des siècles de séduction. Pas de longue présentation entre eux. Juste des mots en équilibre sur le mécano du désir.
Elsa aimait
Heart of glass de Blondie et la vieille variété française ; Théo aussi. Elle ne ratait aucune des retransmissions de Rolland-Garros ; il pensait, chaque jour, à la volée de revers de John Mac Enroe. Elle ne lisait que des romans d’amour ; il affirmait que tous les romans étaient des romans d’amour. Elle était persuadée que le monde pouvait changer ; il haïssait la tolérance, ce vice des faibles et des imbéciles. Elle adorait enfiler, très lentement, des bas résilles ; il chérissait l’art de les retirer, tout aussi lentement. Elle jouait les provocatrices ; il esquivait les piques mouchetées avant de resserrer l’étreinte.
_ Vous avez bien fait de me suivre
_ Je n’avais pas le choix.
_ Pourquoi ?
_ J’avais soif.
Ils goûtaient tous les deux l’atmosphère des bistrots. Théo avait fait de ces lieux de plus en plus improbables le
home sweet home de ses errances. Elsa y allait souvent boire un verre, en fin de journée. Toujours un Gin fizz. Seule ou avec une amie. Selon les jours, elle draguait, se faisait draguer. Si personne ne lui tapait dans l’oeil, elle rentrait chez elle se brancher sur des sites de rencontres.
_ J’y trouve toujours une partie de cul.
Les jeunes filles du XXIe siècle prisaient les sites de rencontre. Les magazines y consacraient de pleines pages. Les jeunes filles en parlaient facilement entre elles. Elles le racontaient aussi à quelques hommes, au détour de longues conversations, d'abord légèrement gênées puis plus assurées par l'intérêt qu'elles provoquaient chez leur interlocuteur.
Elsa avait dit ça très naturellement. Théo apprécia surtout la forme prise par ses lèvres quand elle prononça le mot « cul ». Même s’il avait du mal à comprendre qu’une jolie demoiselle se plante des heures devant l’écran de son ordinateur pour dégotter, après lecture des fiches produits, une queue éphémère. Au calibrage informatique, Théo préférait l’imprévu des apparitions impromptues. Dans la rue, les bars ou au hasard d’une soirée où règne l’ennui.
_ Ca vous plaît, la baise anonyme ?
_ Ca ne me plaît pas : ça me réchauffe.
_ Il y a des couvertures pour ça.
Surprise, Elsa répliqua calmement qu’elle aimait faire l’amour quand elle le souhaitait et qu’il était vraiment « Old school ».
_ C’est-à-dire ?
_ Un trentenaire qui ne veut pas vieillir et qui se cache derrière l’alcool, la fumée et les mots.
_ Je ne me cache pas : je suis près de vous.
_ C’est ce que je disais : vous jouez sur les mots.
Théo ne la contredit pas. Elle l’avait plutôt bien percé. Les mots étaient sans doute ce qu’il possédait de plus précieux. Avec la mémoire obsédante de la peau des femmes, que l’alcool et la fumée paraient d’un masque de brume.
D’un regard, il encouragea Elsa à poursuivre. Elle passa en revue des figures d’inconnus consommés à la va-vite. Pendant qu'elle parlait, elle jouait avec son crucifix, le caressant, le mordillant l'instant d'un silence. Théo fixa ses mains puis ses lèvres. Elle s’interrompit et lui jeta, telle une excuse, qu’elle n’était pas croyante.
_ C’est dommage.
Théo voulait surtout lui signifier qu’elle n’avait aucun compte à rendre, qu'il ne fallait pas s'arrêter. Elle parut chanceler sur son tabouret américain. Fragile comme après une gifle inattendue. Elle se sentit encore obligée de se justifier.
_ Je trouve ça beau un crucifix. Ça me protège …
Théo n’insista pas, ne demanda pas contre quoi il lui fallait être protégée. Il sourit à nouveau, ce qui eut pour effet de faire disparaître le début de peur apparu sur le visage d’Elsa. Elle se rapprocha, son épaule taquinant la sienne, par instants plus appuyée.
_ J’aime votre manière de boire.
Elle parla ensuite de jouissance et de suicide. Dans de longues phrases où affleurait l’ivresse, elle charria pêle-mêle la lueur triste allumant parfois l’œil de Théo, le rictus enfantin alors pris par ses lèvres, les gestes sensuels et précis de ses mains et sa manière élégante de tenir un long corps dégingandé qui, de temps à autres, semblait prêt à se casser sous le poids du mépris qu’il affichait.
Du « vous », elle passa au « tu » :
_ Tu as la gueule de quelqu’un qui ne dort pas beaucoup.
Depuis huit mois qu’il ne vivait plus avec Constance, Théo avait souvent entendu cette remarque. Avant de décider de s’en aller, Constance désirait une grosse voiture, un bébé et une grande maison. Elle voulait ce qu’elle avait nommé des "preuves d'amour", précisant : « C’est ça ou c’est fini ! » Les grandes blondes ont souvent de drôles d’envies. Théo n’avait rien répondu, s’était enfoncé dans la nuit. Constance lui avait signifié leur rupture par mèle. Quatre ans d’amour vache liquidé d’un clic de souris.
_ Je joue à cache-cache avec la lune.
_ Ca veut dire quoi ?
_ Que je n’en fais qu’à ma fête …
_ Ta bouche est très sexy.
A cet instant, Elsa attendait que Théo l’embrasse. Plus tard, elle avouera qu’elle avait été surprise. « Il est timide », pensa-t-elle. Ca lui parut bizarre. Théo n’avait pas du tout l’air timide.
Il était minuit passé. L’alcool commençait à taper les neurones. Théo se resservit un verre en appelant Elsa « ma jolie pute en rouge ». Elle grimaça – une grimace adorable.
_ L’air offusqué te va à ravir.
Elle fit semblant de n’en rien croire :
_ Tu me prends pour une pute ?
Théo lui parla des putes. Celles qu’il payait, rue Saint-Hélier ou avenue Louis Barthou, pour laisser la langue de la rue cracher sa salive sur l’ennui. Celles qu’il ne payait pas, dans des maisons bourgeoises ou des studios d’étudiantes, pour pouvoir quand même toucher l’aube en mortelle compagnie.
Elsa ne voulut pas en entendre davantage. Elle n’était pas ce genre de fille. Il était misogyne, horriblement méprisant. Elle se demandait ce qu’elle faisait encore près de lui.
_ Et puis arrête de sourire ! Ce n’est pas du tout drôle ce que tu me racontes !
Théo conserva son sourire, lui demanda de se calmer et de le laisser terminer. Ses histoires de putes étaient drôles et tragiques, plus drôle et plus tragique que ce qui pouvait se passer sur un site de rencontre. Elsa possédait justement la classe, drôle et tragique, des amazones qui mettent leur vie à la portée d’une bite et d’une barbe de trois jours. La classe d’ une danseuse du macadam.
Elsa retrouva le sourire. La danseuse l’enchantait et remisait la pute aux oubliettes de la soirée.
_ Chez moi, je mets la musique, je pousse le volume à fond et je danse en me regardant dans un miroir…
Elsa raconta ses premiers cours de danse classique. Elle avait commencé, à huit ans, au conservatoire de Rennes. Elle y allait les mercredi et les samedi après-midi, son tutu et ses pointes rangés dans un sac à dos noir et blanc en forme de panda. Quand elle se présenta avec ses hanches et ses petits seins déjà joliment arrondis, le professeur la trouva un peu vieille. Le discours habituel du professeur de danse : toujours trop vieille, trop grosse, trop maigre, pas assez souriante, pas assez souple. Elsa passa outre l’indécent jugement.
_ Pendant longtemps, j’ai été la plus douée, la plus en vue dans les ballets de fin d’année. Puis j’en ai eu ma claque. De la prof, des jalousies. J’ai arrêté le classique. J’ai commencé le modern-jazz en entrant au lycée. J’y vais encore, parfois, quand je ne veux plus danser seule devant ma glace…
Théo la coupa dans son récit :
_ La danse, c’est l’enfance qui dure.
Il imagina Elsa sur scène, semblable aux fées en ballerines qu’il avait autrefois admirées en compagnie de sa mère, à Brest. La révélation enfantine du corps des danseuses. Son éducation à la beauté, dans l’obscurité feutrée d’un théâtre, au point de rencontre de la rue de Siam et de la rue Jean Jaurès. Un poignet, un coude bougent. Les jambes se croisent, dénouent les vieilles offenses qu’elles effacent d’un mouvement miraculeux.
La suite eut le délié nerveux d'un sprint. Elsa recommanda un Gin-Fizz, grignota une olive verte avant d’arracher une page de carnet sur laquelle elle griffonna quelques mots. Elle plia la feuille, vida son verre et, d’un coup d’aile, s’enfuit. A peine le temps pour Théo de tourner la tête, de recevoir un baiser léger à la commissure des lèvres, cet endroit unique doux comme une promesse.
Elsa s’était envolée comme un petit rat quitte le rond de lumière de la poursuite, se retire dans sa loge. Pour changer de tenue, déguster un verre de Pouilly, inspirer quelques effluves de brouillard avant le rappel.
Resté seul au comptoir, Théo déplia la feuille. Y était inscrit un numéro de téléphone portable. Suivi de « A très vite ». Signé « Ta jolie pute en rouge ».
Bien plus tard, il devait être trois heures du matin, il la rappela :
_ Tu as oublié ton béret.
_ J’ai fait exprès…
_ Dis-moi quand je t’embrasse.
_ Maintenant.