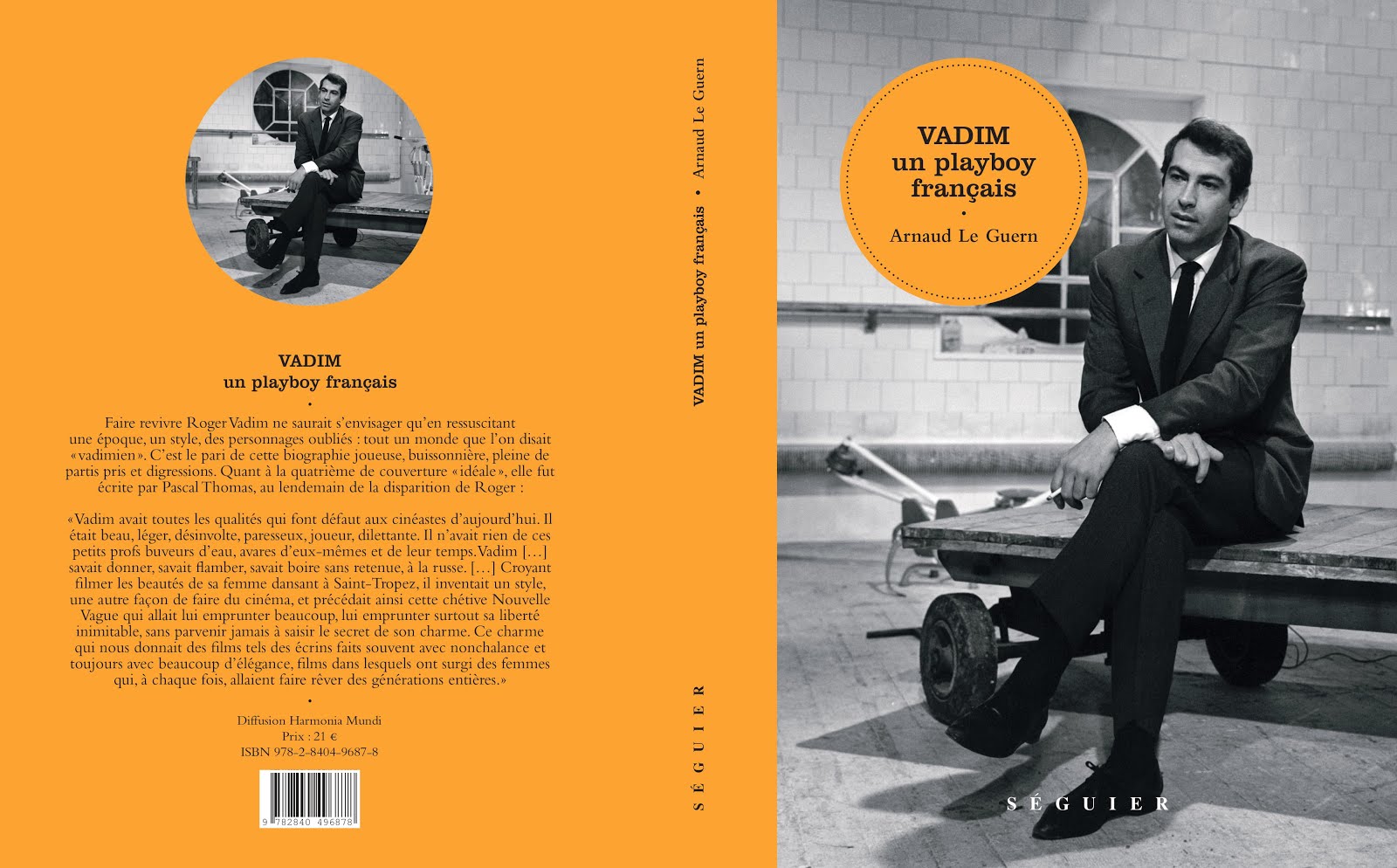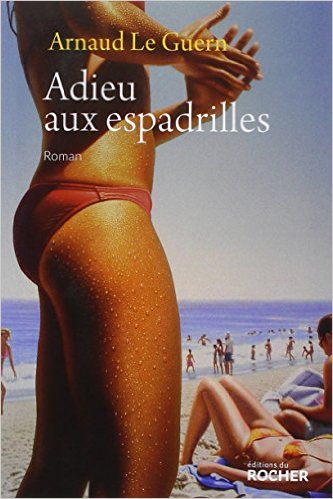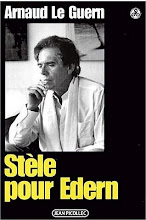Philippe Val a deux défauts principaux : il pense bien - le bon, c'est lui ; la brute et les truands, c'est les autres ! - et il écrit mal.
Comme personne ne se permet de le lui dire, il continue de s'inviter sur les plateaux Télé pour postillonner ses diktats et de publier quelques dépliants indigestes : Vingt ans de finesse avec son compère chansonnier, ami des grands et surtout des petits, Patrick Font, Traité de savoir-survivre par temps obscurs où, plus crétin que facétieux, il confondait la philosophe Simone Weil avec l'ancienne ministre Simone Veil, et le dernier, au titre beau comme du Claude Sarraute d'antan : Reviens Voltaire, ils sont devenus fous.
Pourquoi coincer Voltaire, le pauvre, dans un tel traquenard ? Val croit tenir, non pas son "Affaire Calas", mais deux affaires du même tonneau qui le transforment illico en rempart démocratique contre le fascisme rampant : la publication, dans Charlie-Hebdo, de caricatures de Mahomet et le renvoi, pour antisémitisme larvé, de Siné.
Evidemment, quelques associations musulmanes ont fait un procès qu'a gagné facilement un Val soutenu par tous les pieds-pensants hexagonaux - de Sarkozy à Bayrou, en passant par François Hollande. Evidemment, Siné a lancé une poignée d'insultes qui firent la joie, un court moment, de l'opinion. Pas de quoi en faire une "nervous breakdown" aurait dit Audiard.
La France avait-elle besoin d'un Zorro, d'un Voltaire ou, même, d'un Sartre pour prendre sa défense ? Que nenni. Elle avait mieux : Philippe Val, le Zéro de la République, léger comme une grosse Bertha ou un Béhachèle : "Reculer sur des principes aussi fondamentaux que l'anti-intégrisme et l'antiracisme, à long terme, c'est ouvrir une voie royale à la fois aux intégristes et aux racistes."
Plutôt qu'un rempart, Val apparaît comme un trou où tout tombe à plat : les intentions, la réflexions, les mots. Une dernière descente, pour la route : " La mutation de l'humanité par l'accroissement de ses libertés bouleverse et bouleversera de façon irrémédiablement irréversible les arts, la politique, l'amour, l'amitié, la sexualité, les langues..."
Allo Charlie bobo, le fou, c'est Val !
Philippe Val, Reviens Voltaire, ils sont devenus fous, Grasset, 295 pages.
Papier paru dans Service littéraire, le 18/12/08.
Le site ouèbe de Service littéraire, journal dirigé par l'excellent François Cérésa : http://www.servicelitteraire.fr/